
L’espace conférences est situé au niveau du Pavillon d’entrée.
Les conférences sont gratuites. Pas d’inscriptions. Pensez à vous rendre à votre conférence en avance car les places sont limitées.
Consultez le programme détaillé de l’édition 2025 !
Cycle sous l’égide de Spas Organisation
Vendredi 7 novembre 2025 : A l’échelle locale : continuer à défendre le vivant et à diffuser la bonne information
Modération de la journée : Françoise Vernet
11h – Projection du documentaire « Le vivant qui se défend » de Vincent Verzat (1h30)
 Le vivant qui se défend est un long métrage documentaire de Vincent Verzat, produit par Partager c’est Sympa. Le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation. Partant d’un récit personnel et sensible, le film fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. Le VIVANT qui se défend trace un chemin pour vivre digne et affronter ce qui vient.
Le vivant qui se défend est un long métrage documentaire de Vincent Verzat, produit par Partager c’est Sympa. Le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation. Partant d’un récit personnel et sensible, le film fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. Le VIVANT qui se défend trace un chemin pour vivre digne et affronter ce qui vient.
En 2015, Vincent Verzat lance la chaîne de vidéos Partager c’est Sympa sur Facebook et Youtube, pour réagir à des sujets d’actualité. D’abord seul, il est rapidement rejoint par deux collègues et l’équipe se place en soutien des associations et ONG militantes environnementales : grâce à des vidéos rythmées, filmées au cœur de l’action, et une figure principale qui guide les spectateurs à l’intérieur des mobilisations, Partager c’est Sympa amplifie la voix du mouvement climat français.
Structurée sous la forme d’une association, la chaîne grossit jusqu’à avoir quatre salariés. Elle s’autonomise rapidement grâce au financement participatif qui permet directement aux gens de contribuer à soutenir la chaîne. Cette autonomie permet à Partager c’est Sympa de s’orienter vers des sujets plus complexes, qui relèvent moins de l’actualité brûlante, et de les explorer dans des formats qui laissent plus de place à l’investigation.
Suivi à 12h30 d’un échange avec Lionel Astruc, auteur du livre Activiste d’élite, Méthodes et victoires de Lucie Pinson contre la finance fossile (Actes Sud) et Juliette Duquesne, autrice du livre Autonomes et solidaires pour le vivant, s’organiser sans l’autorité de l’Etat (Le bord de l’eau).
À contre-courant du défaitisme ambiant, Lucie Pinson obtient des victoires écologiques décisives. Ses méthodes ? Développer une expertise de haut niveau ; révéler des informations ; négocier et accompagner ; parfois occuper le siège d’une banque et y déverser des tonnes de charbon. Lauréate du prix Goldman, équivalent d’un Nobel environnemental, elle nous entraîne dans ses combats contre des grands projets d’infrastructures fossiles aux États-Unis, en Australie, en Indonésie et en Ouganda. D’abord impliquée aux côtés des Amis de la Terre, elle a ensuite fondé Reclaim Finance en 2020. Cette ONG compte aujourd’hui 42 salariés et entend mettre enfin le système financier au service des impératifs sociaux et écologiques.
Lionel Astruc est auteur de dix-huit livres consacrés à la transition écologique. Il a mené de nombreuses enquêtes sur les filières de matières premières, les origines de nos biens de grande consommation et les initiatives pionnières pour transformer la société. Plusieurs de ses ouvrages ont été publiés dans la collection Domaine du Possible dont un livre d’entretiens avec Vandana Shiva : Vandana Shiva. Pour une désobéissance créatrice et, en 2015, Le Pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant, avec Rob Hopkins. En 2017 il publie un roman d’investigation intitulé Traque verte. Les dernières heures d’un journaliste en Inde. En 2018, il publie Le cercle vertueux qui est une série d’entretiens avec Nicolas Hulot et Vandana Shiva et l’Art de la fausse générosité, publié en mars 2019. Il publie en 2023 Les Sept cabanes.
Parmi ceux qui souhaitent préserver le vivant, une divergence n’est pas toujours bien formalisée : notre rapport à l’État. Certains prônent la planification, alors que pour d’autres, l’État fait structurellement partie du problème. L’enjeu : construire un quotidien autour des gestes essentiels tels que se nourrir ou se loger, ensemble, sans l’autorité de l’État.
En France, les initiatives ne manquent pas : habitats partagés, coopératives, ZAD, associations, communes… Elles expérimentent d’autres manières de faire vivre la démocratie. Dans le monde, dans des régions comme au Chiapas au Mexique, les zapatistes bâtissent leur autonomie depuis plus de 20 ans.
Sans les idéaliser, ces collectifs montrent qu’il est possible d’habiter un lieu et d’en prendre soin avec davantage de solidarité de façon plus autonome et non autarcique.
Juliette Duquesne a interrogé plus d’une centaine de personnes. En entremêlant cas concrets et réflexions théoriques, ce livre permet d’ouvrir nos imaginaires à différentes échelles et de relier les expériences actuelles à des courants historiques tels que l’anarchisme.
Autrice, conférencière, journaliste indépendante spécialisée dans les thématiques écologiques et économiques, Juliette Duquesne est coautrice de six livres (avec Pierre Rabhi, aux Presses du Châtelet) : Pour en finir avec la faim dans le monde ; Les semences, un patrimoine vital en voie de disparition ; Les excès de la finance ou l’art de la prédation légalisée ; L’eau que nous sommes ; Vivre mieux sans croissance ; L’humain au risque de l’intelligence artificielle. Auparavant, elle a travaillé pendant dix ans pour le journal de TF1.
14h – Table ronde – Quand les élus œuvrent pour « manger sur son territoire »
L’autonomie alimentaire de nos territoires … tout un programme. Sont évoqués des délais de 1 à 4 jours pour les grandes villes, pas beaucoup mieux pour les territoires ruraux. La France a fait le choix de la spécialisation : l’élevage en Bretagne, les céréales en Beauce, le maïs dans le grand sud-ouest, … Or comme chacun sait se nourrir de maïs en buvant du vin à l’ombre des oliviers ne nous permettra pas de vivre bien longtemps.
A cela se rajoute un modèle agricole toujours aussi dépendant des énergies fossiles, des tensions géopolitiques qui ne cessent de s’intensifier, des échanges économiques instables, … Notre modèle agricole et alimentaire actuel, présenté comme un levier de puissance et de souveraineté, est en réalité extrêmement vulnérable.
La plupart des départements français affichent un potentiel nourricier honorable, au moins pour certains produits. Pourtant, les chances pour que ce qui se trouve dans votre assiette vienne des fermes et usines alentour sont très faibles !
Alors saluons celles et ceux qui œuvrent pour cette relocalisation et cette autonomie !
Jérémy Camus, Vice-Président de la Métropole de Lyon sur l’agriculture
Eve Demange, Conseillère municipale déléguée en charge de la résilience alimentaire, du quartier de La Bastide, Conseillère métropolitaine à Bordeaux, Conseillère départementale de la Gironde
Pierre Leroy, président du Pays du Grand Briançonnais, du Guillestrois, du Queyras et des Écrins et coauteur du livre Petit manuel de démocratie vivante (Actes Sud)
16h – Projection du document « Cultiver la pluie » de Marc Khanne (55’)
Trop d’eau, pas assez d’eau, sécheresses, inondations, leurs conséquences dramatiques sont-elles inévitables ? Pouvons-nous agir ? Les trois auteurs du film ont enquêté auprès du botaniste Francis Hallé, grand défenseur de la forêt naturelle et d’une bonne douzaine d’acteurs et d’agriculteurs engagés sur la gestion intelligente de cette précieuse ressource. Du Larzac au Béarn, du Roussillon à l’Alsace et même à l’une des îles du Cap-Vert où il n’a pas plu depuis treize ans, l’agroforesterie, le maraîchage sur sol vivant et l’hydrologie régénérative démontrent leur efficacité face aux à-coups climatiques.
Après avoir été musicien et comédien, Marc Khanne réalise des films depuis plus de 25 ans. Une quinzaine de ses films ont été primés en festivals ou diffusés à la télévision. Il collabore aussi à l’image ou au montage de films documentaires ou à la mise en scène de docu-fictions ou fictions comme premier assistant.
17h – Table ronde – L’eau, continuer à tout faire pour la préserver
Alors que les besoins en eau dans le monde ne cessent d’augmenter, la ressource est quant à elle limitée. Aussi l’enjeu pour les années à venir consiste à préserver la quantité et la qualité de l’eau pour assurer une quantité suffisante d’eau douce disponible pour la population.
Qu’est-ce qui consomme le plus d’eau en France ? Entre 2010 et 2019, les consommations d’eau se sont réparties ainsi :
- 58 % pour l’agriculture
- 26 % pour la production d’eau potable
- 12 % pour le secteur de l’énergie (refroidissement des centrales électriques)
- 4 % pour l’industrie (touristique et agroalimentaire notamment)
Il est donc urgent de prendre soin de cette ressource qui est un bien commun. Plusieurs pistes sont explorées notamment en agriculture – avec l’agroforesterie, l’agroécologie – mais aussi dans l’industrie, dans les collectivités locales, … Élus, formateurs, enseignants, chercheurs, maraîchers, éleveurs, citoyens engagés, conservateurs de variétés anciennes œuvrent inlassablement à rétablir les équilibres et mettent en œuvre des exemples concrets de solutions. Villes-éponges, réalisation de baissières, de jardins comestibles, plantation d’arbres, de nombreuses réalisations liées à ce que l’on nomme « l’hydrologie régénérative ».
Martin Arnould, consultant pour la restauration des rivières au sein de la coopérative d’activité et d’emploi Oxalis, membre de l’organisation non-gouvernementale Le Chant des Rivières et auteur du livre Au pied du barrage, la lutte oubliée pour la Loire sauvage (Actes Sud)
François Rouillay, chercheur, conférencier en agriculture urbaine et coauteur du livre Cultiver la pluie (Terre Vivante)
Sabine Becker, chercheur, coautrice du livre Cultiver la pluie (Terre Vivante), ingénieure-urbaniste et conférencière dans le développement personnel, dans la relation à soi, à l’autre et à la Terre.
Cycle sous l’égide de Nature & Progrès
Samedi 8 novembre 2025 : L’agriculture bio est politique et humaniste
10h30 Projection du documentaire « Sur la paille » d’Éric Guéret (1h13)
 Olivier Tanguy ouvre il y a quatre ans un élevage de porcs en bio. Mais aujourd’hui, la crise frappe l’agriculture biologique. Ses difficultés sont celles d’un système tout entier. Dans un contexte où la crise environnementale est au cœur des préoccupations des Français, la ferme d’Olivier incarne pourtant un modèle plein d’espoir. Comment comprendre que le seul modèle agricole qui préserve réellement l’environnement et la biodiversité soit abandonné ?
Olivier Tanguy ouvre il y a quatre ans un élevage de porcs en bio. Mais aujourd’hui, la crise frappe l’agriculture biologique. Ses difficultés sont celles d’un système tout entier. Dans un contexte où la crise environnementale est au cœur des préoccupations des Français, la ferme d’Olivier incarne pourtant un modèle plein d’espoir. Comment comprendre que le seul modèle agricole qui préserve réellement l’environnement et la biodiversité soit abandonné ?
11h45 – Table ronde – La bio bien plus qu’une logique de marché
L’agriculture biologique est plus que jamais malmenée de toutes parts. Et si nous revenions aux fondamentaux, aux enjeux biologiques, sociaux, et donc politiques, en nous concentrant sur les contraintes de production et sur les questions de la souveraineté et de la sécurité alimentaire qui concernent toute la population ?
Avec Emmanuel Antoine, fondateur de Graines de Liberté, Bastien Moysan, secrétaire national de la Confédération Paysanne, Jean-Philippe Martin, docteur en histoire, auteur de Histoire de la nouvelle gauche paysanne et de Paysannes, Histoire de la cause de femmes dans le monde agricole des années 1960 à nos jours.
14h30 – Table ronde – Quelles semences pour repenser le vivant ?
Le vivant est un élément de la lutte et d’émancipation pour nos société. Comment la question des semences s’inscrit-elle comme un enjeu biologique incontournable si nous voulons vraiment faire bouger les lignes ?
Avec Marie-Océane Fékaïri, membre du Réseau Semences Paysannes et des Jardins des Thorains, et Nicolas Supiot, paysan boulanger Nature & Progrès, chercheur et formateur en agroécologie et semences paysannes.
16h30 – Table ronde – L’agroécologie est-elle soluble dans les idéologies d’extrême-droite ?
Comment promouvoir et défendre au cœur de nos actions les questions de diversité et de la justice ? Comment l’écologie peut-elle être utilisée pour défendre un terroir et servir dans le même temps un discours anti-humaniste ? Quand certains choisissent l’extrême droite, voire des groupuscules encore plus extrémistes, comment arriver à faire agriculture ensemble ?
Avec A4 – association d’accueil en agriculture et artisanat, Erwan Lecœur, sociologue, enseignant chercheur en communication, spécialisé dans les questions touchant à l’extrême droite et à l’écologie politique, Bastien Moysan, porte-parole de la Confédération Paysanne et Antoine Dubiau, doctorant en géographie à l’université de Genève et auteur de Écofascismes.
Dimanche 9 novembre 2025 : Devenir paysanne, paysan, pourquoi et comment ?
10h30 – Projection du documentaire « Leurs champs du cœur » de Mickaël Denis-Shi (1h16)
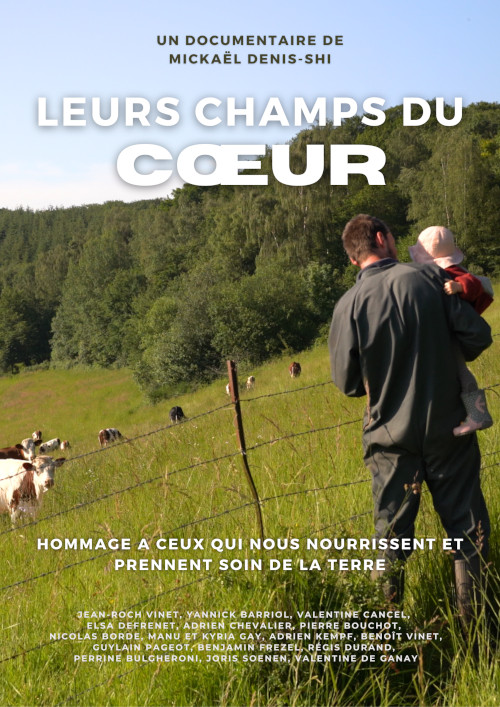 Un tour de France de douze fermes à la rencontre de paysannes et de paysans, avec leurs coups de gueule, leurs convictions et leur volonté de s’adapter face à l’urgence des enjeux.
Un tour de France de douze fermes à la rencontre de paysannes et de paysans, avec leurs coups de gueule, leurs convictions et leur volonté de s’adapter face à l’urgence des enjeux.
Suivi d’une table ronde – De l’idée à l’installation…
Qu’est-ce qui pousse à devenir paysanne ou paysan ? Comment être accompagné au mieux quand s’installer nécessite souvent de faire face à de nombreux défis ?
Avec Léna Lazare, paysanne en cours d’installation, Daphné Mervoyer, présidente de l’espace-test agricole Graines de Paysans (11) – Réseau RENETA, et William Petipas, coordinateur de l’association Alterfixe.
13h45 – Projection libre « Retour à la terre, changer l’agriculture pour changer le monde » d’Alexandra Riguet (1h10)
A l’heure où le monde bascule, de jeunes agricultrices anticipent les grands changements de notre société. Elles font partie de la jeunesse qui a décidé que l’on peut changer notre manière de vivre sur cette planète. En dépit des alertes et des aléas climatiques, du mal être du monde agricole, elles ont décidé de revenir sur les terres de leurs parents.
15h – Table ronde – Plus solides et plus créatifs en collectif !
Avec Sylvain Mervoyer, éleveur bovin bio en vente directe, administrateur FR-Cuma Occitanie, trésorier du magazine national des CUMA Entraides, la Ferme du Ser Clapi à Mens (38).
17h – Conférence – Comment pratiquer une agriculture intelligente pour pérenniser son activité ?
Maraîcher depuis dix ans dans le Sud-Ouest, Quentin d’Hoop offre une vision élargie et transdisciplinaire de sa pratique. Comment élaborer son projet agricole à taille humaine et se maintenir dans le temps ?
Avec Quentin D’Hoop, paysan, agrégé de géographie physique et titulaire d’un master en gestion rurale, auteur de La culture maraîchère biologique, techniques, pratiques, philosophies, préface de Marc-André Selosse.
Lundi 10 novembre 2025 : De la mécanisation aux nouvelles technologies, dans quelle agriculture vivons-nous ?
10h30 Projection du documentaire INA « Le remembrement agricole » – 1965 (6’)
Petite histoire du remembrement dans la petite commune de Mirepoix-sur-Tarn.
 « Adieu terroir » 1971 (13’)
« Adieu terroir » 1971 (13’)
Les ravages du remembrement en Bretagne
Suivi d’une conférence – Le remembrement : quand la réunion des terres divisait la paysannerie
Les opérations de remembrement ont redessiné les territoires agricoles depuis les années 1950, accélérant ainsi le développement de la mécanisation et semant au passage la discorde dans les campagnes.
Avec Léandre Mandard, doctorant au Centre d’histoire de Sciences-Politique, conseiller historique pour la BD Champs de Bataille, l’histoire enfouie d’un remembrement, une enquête d’Inès Léraud.
15h – Conférence – Agriculture industrielle : où est le bon sens ?
L’agriculture est actuellement dominée par un modèle industriel puissant, visant une production de masse standardisée et uniformisée. Ravageur pour l’environnement comme pour les communautés paysannes, ce modèle se révèle incapable de s’adapter aux mutations climatiques et doit d’urgence être remplacé.
Avec Jacques Caplat, agronome, ethnologue ; fils de paysan, coordinateur des campagnes Agriculture & Alimentation à l’association Agir pour l’environnement et auteur de Agriculture industrielle, on arrête tout et on réfléchit !
17h – Table ronde – Technologies paysannes versus technologies de l’agriculture industrielle
Et si on dézoomait deux minutes de cette fuite en avant où notre survie ne dépendrait que du progrès technique et des nouvelles technologies ? Car oui, nous avons bel et bien des technologies paysannes pour préserver et développer une agriculture pleine du bon sens paysan !
Avec Marie Garin, sociétaire de l’Atelier Paysan et Marie-Océane Fékaïri, membre du Réseau Semences Paysannes et des Jardins des Thorains.
Mardi 11 novembre 2025 : Ensemble, cultivons les luttes !
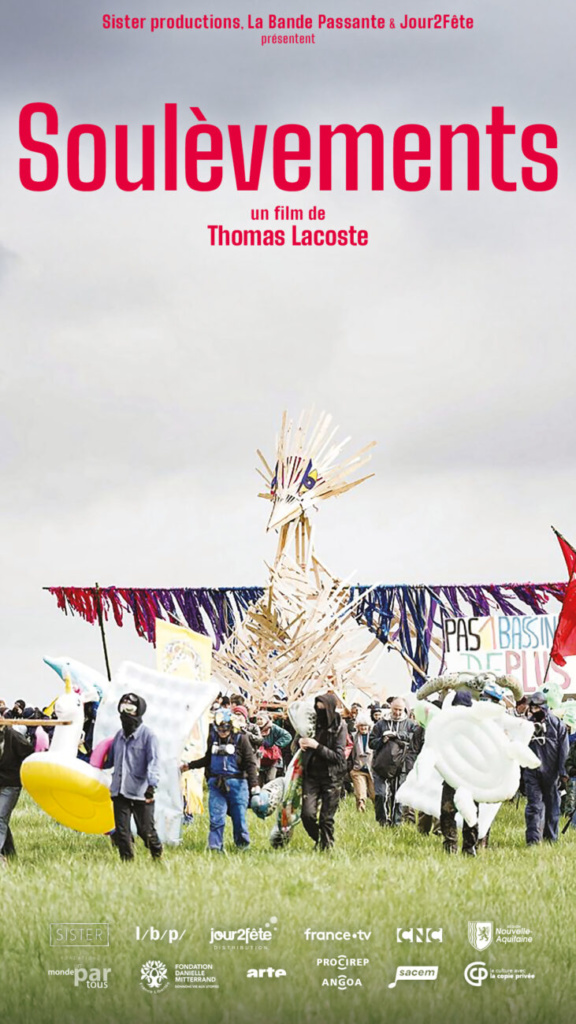 10h30 – Documentaire – « Soulèvements » de Thomas Lacoste (1h45)
10h30 – Documentaire – « Soulèvements » de Thomas Lacoste (1h45)
Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique.
12h15 – Table ronde – Écologistes et mouvements sociaux et citoyens : les nouvelles alliances
Quand chaque semaine, de nouveaux projets mortifères voient le jour, il est plus que jamais nécessaire de développer d’autres stratégies et de créer de nouvelles alliances pour défendre le vivant.
Avec Dam des soulèvements de la Terre Île-de-France et Martin Fraysse, militant des Soulèvements de la Terre
15h – Table ronde – Semi-conducteurs, extractivisme, etc. : quand la société civile se mobilise…
Comment se mobiliser face à cet appétit toujours plus glouton des géants du numérique ? Comment stopper cette course en avant pour extraire toujours plus de lithium et pour nous faire croire à une relocalisation des semi-conducteurs pourtant impossible ?
Avec le collectif Stop micro (38) et le collectif Stop mines 03.
17h – Conférence – La révolte, parce nous sommes l’eau
Notre cerveau contient 80% d’eau, et nous avons laissé faire son assassinat. Le seul chemin est celui d’une révolte collective, pacifique, mais déterminée.
Avec Fabrice Nicolino, journaliste-essayiste, auteur de C’est l’eau qu’on assassine, Bidoche, Pesticides, révélations sur un scandale français, etc.
Consulter le programme de 2024
Consultez le programme de 2023
Consulter le programme de 2022
Consulter le programme de 2021
Consulter le programme de 2020
Consulter le programme de 2019
Consulter le programme de 2018
Consulter le programme de 2017
Consulter le programme de 2016
